En ce mois de janvier, nous entamons notre sixième année d’activité. En quelques années, nous avons fait bien plus que nous faire une place sur le marché : nous continuons de redéfinir les standards de la banque de flux pour les entreprises. Là où les acteurs historiques peinent à se moderniser, notre infrastructure de paiement API-first et notre agrément d’établissement de crédit français continuent de convaincre un nombre croissant d’entreprises de nous choisir dans la gestion de leurs flux.
Bien que nos clients proviennent d’horizons divers — assureurs, courtiers, sociétés de gestion, gestionnaires locatifs, etc. — un point commun les rassemble : ils ont tous été confrontés à la même problématique de flux. Avec une activité à forte intensité transactionnelle, comment passer à l’échelle sans investir dans des projets informatiques longs et coûteux ?
C’est notre capacité unique à répondre à cet enjeu qui explique l’accélération significative de notre croissance :
Qu’il s’agisse de paiements domestiques ou transfrontaliers, de valorisation de trésorerie multi-devises ou de lutte contre la fraude, nous avons été présents sur tous les fronts qui facilitent le passage à l’échelle.
Nous remercions nos clients, ceux fidèles depuis notre lancement en 2020 ou ceux qui nous ont rejoints en cours de route. Pour les lecteurs qui nous découvrent, nous espérons que notre bilan de l’année 2025 saura vous convaincre que le passage à l’échelle est, plus que jamais, à votre portée.
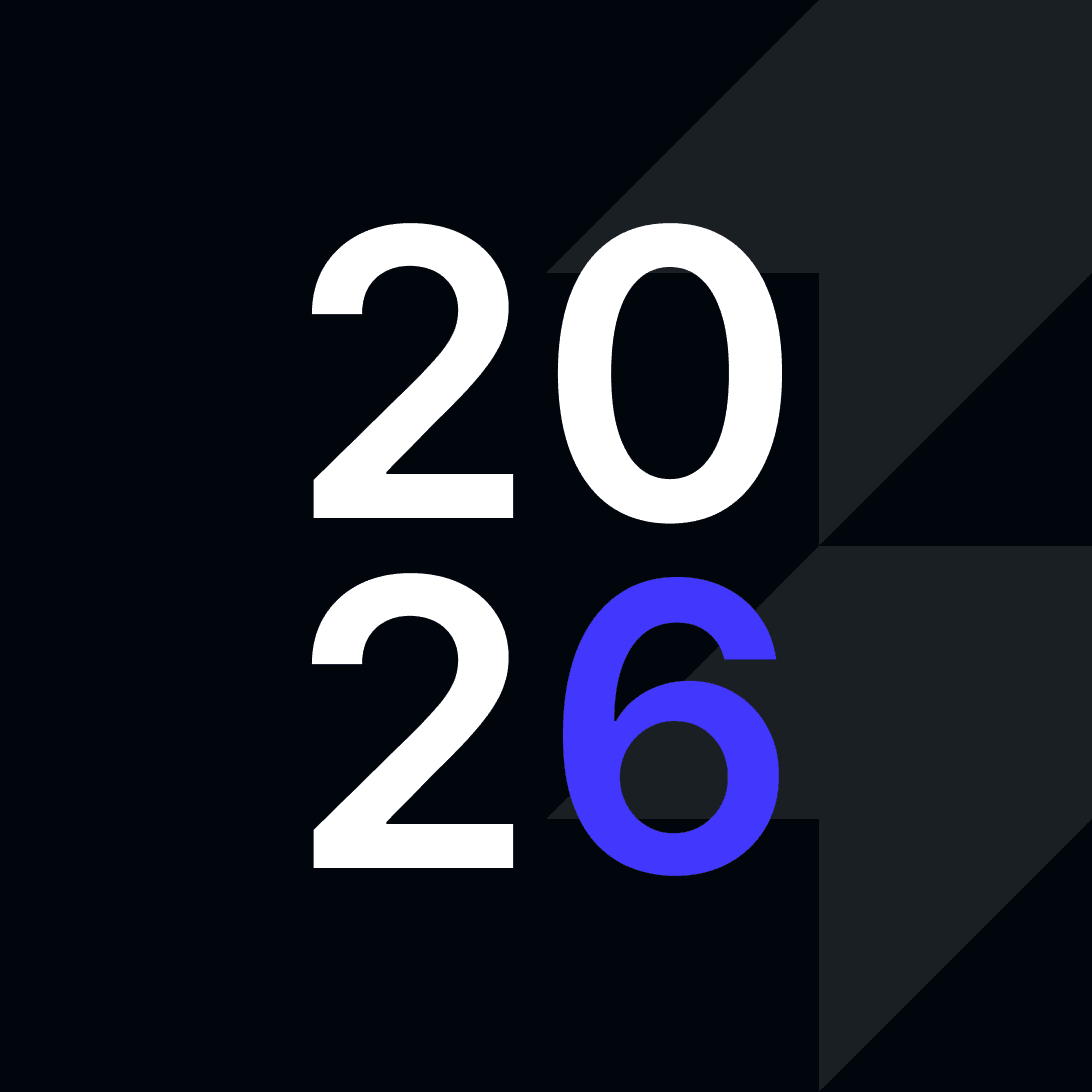
Les entreprises jonglent désormais avec bien plus de variables qu’il y a 10 ans : des coûts qui ne cessent de grimper, des délais de paiement sous pression, des clients exigeants et un accès au financement beaucoup plus sélectif. Bien gérer son besoin en fonds de roulement (BFR) n’a donc jamais été aussi stratégique.

Un prélèvement est une opération qui permet à un créancier de demander à son partenaire financier (banque traditionnelle, fintech, etc.) de débiter le compte d’un payeur (son client).
Depuis l’harmonisation européenne mise en place en août 2014, on parle de prélèvement SEPA pour « Single Euro Payments Area ». Il s’agit d’un espace unique de paiement en euros comprenant l’ensemble de l’Union européenne et plusieurs pays associés. Le prélèvement SEPA a remplacé le dispositif connu sous le nom de prélèvement national, ou plus communément « autorisation de prélèvement ».
Le prélèvement SEPA est largement adopté dans des secteurs comme l’assurance, l’immobilier, l’énergie ou les services par abonnement. Il séduit particulièrement les entreprises facturant régulièrement et cherchant à optimiser leur taux de recouvrement.
Cet article a pour objectif de vous présenter les bases de ce mode de prélèvement, de sa mise en place jusqu’aux critères à considérer pour le choisir.

En 2024, la situation financière des PME et ETI est demeurée sous tension (Source : Banque de France). Entre l’inflation persistante, la hausse du prix des matières premières et un accès au financement parfois limité, les PME doivent composer avec des défis majeurs. Les dernières études démontrent que beaucoup peinent à renforcer leur trésorerie ou à générer suffisamment de marge pour investir sereinement dans leur développement.
Dans ce contexte, mettre en œuvre un pilotage financier précis n’est plus réservé aux grands groupes : même les petites structures ont tout intérêt à professionnaliser leurs pratiques et à s’équiper d’outils adaptés. L’objectif ? Établir une base solide pour une croissance durable et prendre chaque décision sur la base de données financières fiables et actualisées.

Au second semestre 2024, les prélèvements représentaient 15 % des paiements scripturaux dans la zone euro, selon la Banque centrale européenne1. Ce mode de règlement est particulièrement adapté lorsqu’une entreprise doit encaisser régulièrement ses clients pour des services récurrents, des abonnements ou des facturations périodiques.
Mais ce processus comporte des étapes souvent sous-estimées : obtention d’un identifiant, collecte des mandats, traitement des rejets, etc. Omettre l’une de ces étapes peut entraîner des retards ou même des impayés. Alors, comment déployer un dispositif de prélèvement SEPA efficace ? Quelles sont les étapes ? Et comment se faire accompagner par sa banque pour le mettre en place ? Faisons le point.

Depuis le 9 octobre 2025, la réglementation “Verification of Payee” (VoP) transforme la manière dont les entreprises valident leurs virements. Pensée pour réduire la fraude, cette mesure impose aux banques de vérifier la concordance entre l’IBAN d’un bénéficiaire et son nom avant chaque paiement. Bonne nouvelle ? Oui… Mais pas suffisant pour répondre aux besoins des directions financières.

Devenu la norme européenne en 2014, le prélèvement SEPA est largement adopté dans des secteurs comme l’assurance, l’immobilier, l’énergie et les services par abonnement. Il séduit particulièrement les entreprises facturant régulièrement et cherchant à optimiser leur taux de recouvrement. Comparé aux autres méthodes d’encaissement (cartes, chèques, espèces), il offre un meilleur taux de recouvrement des créances.
Grâce aux innovations technologiques, ce mode d’encaissement a évolué avec des fonctionnalités avancées telles que l’automatisation des mandats, la gestion des flux par API et la personnalisation des pages de paiement.
Aujourd’hui, le marché foisonne de solutions d’encaissement par prélèvement SEPA. Face à la diversité des tarifications et des fonctionnalités proposées, il peut toutefois être difficile de s’y retrouver. Une fois les bases du prélèvement SEPA rappelées, ce guide vous accompagnera dans le choix de la solution la plus pertinente.
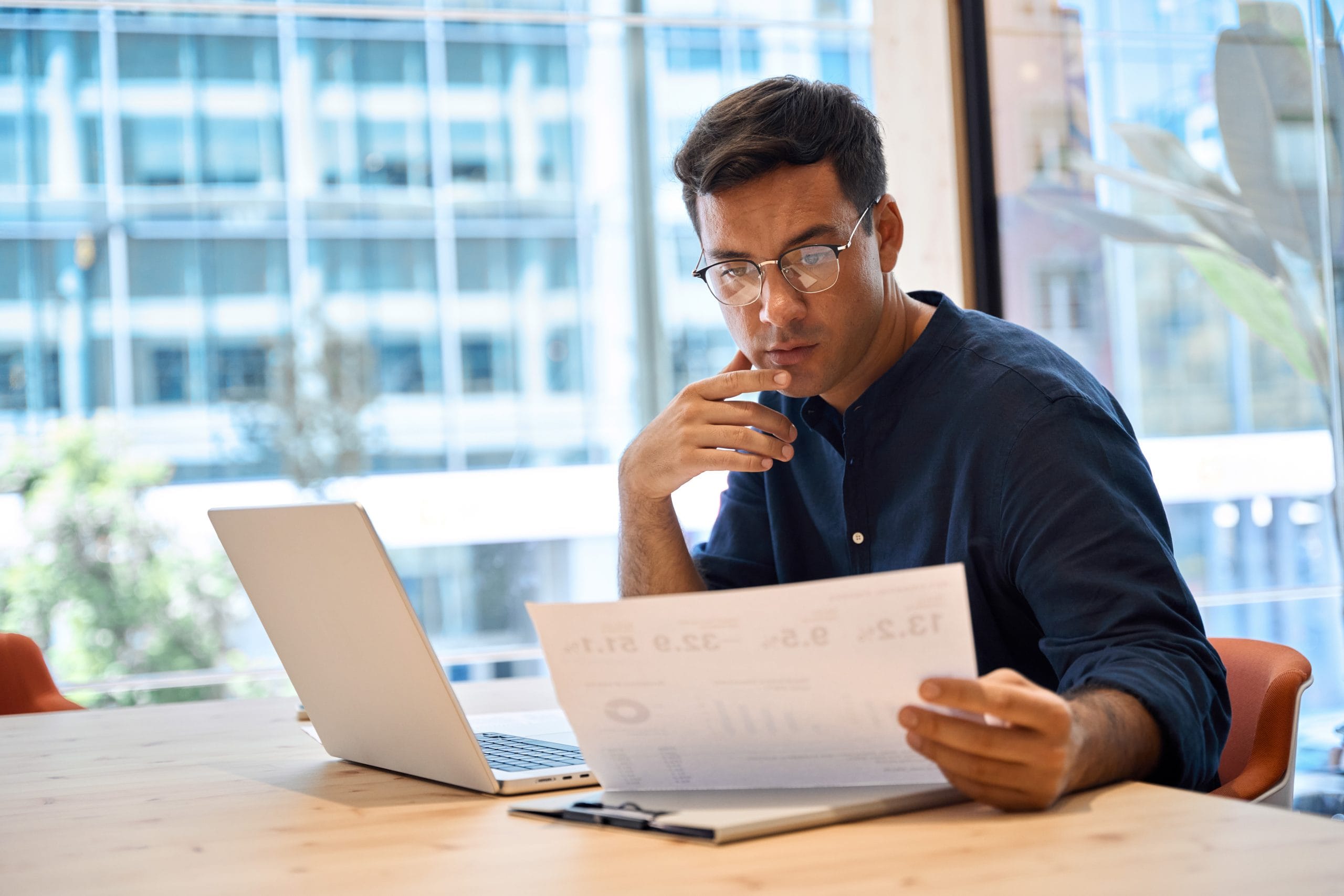
Le prélèvement SEPA est une méthode très fiable pour encaisser les paiements. Il offre aux entreprises une meilleure gestion de leurs flux financiers, tout en libérant leurs clients des contraintes liées aux paiements manuels.
Cependant, même si le prélèvement SEPA est robuste, des échecs de paiement peuvent survenir. Ces échecs sont généralement regroupés sous le terme générique de R-Transactions SEPA : Rejet, Refus, Retour, Remboursement par le créancier et Remboursement par le débiteur.
Pour réduire ces échecs et maximiser le recouvrement de vos créances, il est essentiel de comprendre la nature de chaque R-Transaction. Tous les acteurs financiers (banques ou prestataires de services de paiement) ne fournissent pas toujours ces informations clés, ni les outils pour les anticiper ou les traiter, comme les relances automatiques sur les paiements en échec.
Cet article a pour objectif de vous apporter une compréhension détaillée des R-Transactions SEPA, ainsi que des stratégies concrètes pour optimiser le recouvrement de vos créances.

Au premier semestre 2024, le montant des fraudes liées aux prélèvements SEPA a atteint 16,3 millions d’euros, soit une hausse de 31 % par rapport à la même période en 2023 (source). Souvent utilisé en entreprise pour la gestion des paiements récurrents (abonnements, factures, cotisations), il peut vite devenir source d’erreurs, de litiges ou de blocage s’il est mal structuré. Les retards de paiement peuvent alors durablement impacter votre trésorerie et votre BFR. Dans cet article, nous allons explorer le fonctionnement du mandat de prélèvement SEPA, ses différents types et les étapes de sa mise en place.

La banque comme elle devrait être.
Memo Bank est une société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 13.491.062,75 € agréée en qualité d’établissement de crédit par la Banque Centrale Européenne (Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Allemagne) et contrôlée par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (4 place de Budapest, 75009 Paris). Pour les services d’investissement, Memo Bank agit en tant qu’agent lié de Twenty First Capital, société de gestion de portefeuille agréée par l’Autorité des Marchés Financiers sous le numéro GP-11000029, enregistré à l’ORIAS sous le numéro 25004636.
Cas d’usage
Nous aidons les intermédiaires financiers à protéger et à séparer les fonds collectés pour le compte de tiers, tout en offrant la possibilité de gérer les activités transactionnelles de manière instantanée et autonome.